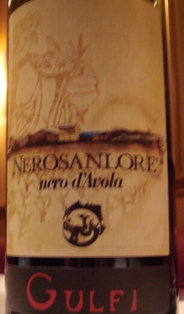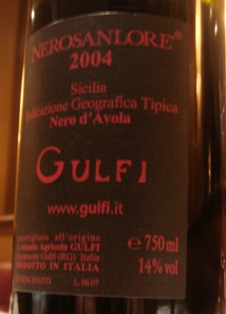L’Académie du Vin de France tient sa « paulée » annuelle dans les salons du restaurant Laurent, qui est le siège de l’académie. La paulée signifie que les membres de l’académie font goûter leurs vins les plus récents. J’ai bu de nombreux vins, tous excellents, dont je citerai certains. En blanc, le Riesling Clos Windsbuhl domaine Zind-Humbrecht 2007 est de belle prestance et le Château de Beaucastel Chateauneuf-du-Pape Vieilles Vignes blanc 2007 m’a fait forte impression. Je l’ai fait goûter à des amis avec des dés de foie gras en gelée et l’accord est saisissant. En rouge un Macon Milly Lamartine Clos du Four domaine Héritiers du Comte Lafon 2007 est fort sympathique et un Côtes de Brouilly Cuvée La Chapelle Château Thivin 2007 a allumé des souvenirs de mon séjour à Lyon il y a plus de quarante ans où une visite des vignobles et des caves du Beaujolais a sans doute été ma première visite à des vignerons, et l’une des très rares de ma vie professionnelle. Ce beaujolais est fort gouleyant. Dans la salle dédiée aux bourgognes, c’est la Romanée Saint Vivant Domaine de la Romanée Conti 2006 qui est impressionnante de perfection. Lors de la présentation des vins de 2005 du domaine de la Romanée Conti, c’est parmi les rouges la Romanée Saint-Vivant qui était la plus délicieuse à boire à ce stade de sa vie. Sa puinée d’un an récidive avec brio. Ce vin au fort parfum annonçant la puissance se montre romantique en bouche.
Dans une autre salle, le Château Simone rouge 2006 m’impressionne par sa pureté. C’est un vin magnifiquement fait et son propriétaire est content que je lui en fasse compliment. Le Château Gazin 2006 me plait beaucoup il a aussi une grande pureté de définition. Un Gewurztraminer Clos Zisser Vendanges Tardives domaine Klipfel 2005, avec 57 grammes de sucre résiduel est d’une légèreté étonnante pour les papilles. Le Château de Fargues 2006 présenté par Alexandre de Lur Saluces est brillant et montre tout le travail accompli par François Amirault, car son final a un panache rare. L’intérêt de cette paulée, de ce cocktail apéritif, c’est aussi de parler avec des vignerons parmi les plus prestigieux de France.
Nous redescendons au rez-de-jardin pour le dîner de gala de l’Académie du Vin de France. Jean-Pierre Perrin, président de l’académie décide d’évoquer avec humour la diabolisation du vin par les pouvoirs publics en traitant ses amis de dangereux dealers (si ce n’est pas en ces termes, cela y ressemble), et l’aimable ironie a un grand pouvoir de persuasion.
Le menu mis au point par Philippe Bourguignon, Alain Pégouret avec Jacques Puisais et Benoît France, secrétaire de l’académie est le suivant : araignée de mer dans ses sucs en gelée / vol-au-vent aux morilles et asperges de printemps / carré d’agneau de lait des Pyrénées grilloté, « frigola-sarda » aux dernières truffes noires / gruyère d’été 2008, reblochon et abbaye de Cîteaux / rhubarbe laquée à la fleur d’hibiscus, sorbet gariguette / palmiers.
Je suis à la table du président et son épouse, d’un médecin de ses amis et son épouse, de Jacques Puisais et je suis à la droite de son épouse, truculente presque octogénaire d’une diabolique jeunesse, de Jean-Robert Pitte et son épouse en ravissant kimono, de Bernard Pivot, sa fille et le mari d’icelle.
Nous commençons par un Champagne cuvée Nicolas-François Billecart Billecart-Salmon 2000. Le champagne est incroyablement lourd, puissant, dominant. L’araignée, véritable institution de ce lieu, a changé de recette et la gelée est très marquée. C’est une variation intéressante qui n’atteint pas la perfection de l’icône du restaurant Laurent dans sa recette à figer dans le marbre. L’accord est difficile du fait de la personnalité tyrannique du champagne très typé.
Le Puligny-Montrachet Les Pucelles domaine Leflaive 2000 a un parfum d’une rare puissance, tonitruant. Il sent le domaine Leflaive à plein nez ! Il est un peu plus mesuré en bouche, fumé, à peine amer, sur un vol-au-vent qui allume mille souvenirs de ma jeunesse. Je le dis à mes voisins de table et ce qui est amusant c’est que Jacques Puisais, dans son traditionnel speech de fin de repas, fera le même rappel à son enfance. On me dira le lendemain qu’à toutes les tables, tout le monde évoquait ses souvenirs d’enfance, tant le vol-au-vent est une institution. Le vin s’adapte très bien au plat délicieux. Il montre un peu d’alcool, mais il est très expressif.
J’ai un peu plus de mal que mes voisins avec le Château Branaire 1998 que je trouve assez monolithique face à un plat goûteux, le plus beau de la soirée. J’en dirai deux mots en fin de repas à Patrick Maroteaux qui convient que le 1998 est un peu ingrat en ce moment et nous échangeons nos idées sur les plus brillants Branaire anciens sur lesquels il a plus d’expérience que moi : 1899, 1900, 1928, 1934, 1945, 1949. Mes voisins de table apprécient l’accord de la belle chair de l’agneau avec ce beau bordeaux.
Le Montrachet Domaine de la Romanée Conti 2000 est, on s’en doute, le clou de la soirée. Si je devais donner un mot qui caractérise ce vin, ce serait « fraîcheur ». C’est assez paradoxal pour l’un des vins blancs les plus puissants qui soient. Mais ce vin réussit le tour de force de combiner puissance, expression et cette incomparable fraîcheur. Le vin est merveilleux et c’est presque une punition de le marier à des fromages, tant son talent mérite de la gastronomie complexe. C’est avec le reblochon qu’il est le plus à l’aise. Jacques Puisais pense que c’est avec le gruyère, mais ce n’est pas mon impression.stronomie complexe. déric les acturesrence entre Acipar, Kadéthe et les autres SCI.
oment et nous échangeo
Le Jurançon « Quintessence du petit manseng » domaine Cauhapé 2000 est un vin direct, naturel, au message intelligent. La rhubarbe a un effet spectaculaire sur lui. Car le vin assez carré se trouve multiplié par l’excitante aigreur des jeunes branches. L’accord me ravit car il est gourmand. Le sorbet n’est pas nécessaire pour le vin mais pour l’équilibre du dessert réussi. Le jurançon est très abricot confit et poivre. Le mariage est le plus excitant de ce repas.
Jacques Puisais est lyrique sur les vins et les accords, quand il prend la parole, choisissant de discourir sur le thème du printemps. Il finit son speech en s’adressant aux vignerons : « vous êtes des croisés du printemps au service du vin ».
Le repas se ponctue avec des palmiers qui sont une autre icône du restaurant. Chacun en recevra un petit paquet au moment du départ. Certains partent, tandis que des vignerons s’installent dans les fauteuils profonds avec la mâle intention de continuer à célébrer Bacchus. Il n’est pas encore interdit par la loi de faire des grands vins et d’être bon vivant.